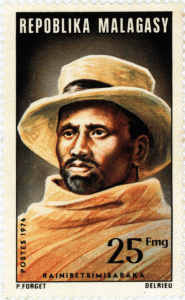
Fin 1895, alors que les Français viennent à peine de prendre Tananarive, capitale du royaume de Madagascar, une révolte éclate en Imerina, au cœur de l’île. Les insurgés, appelés « Menalamba », attaquent les églises et les temples et affrontent les troupes françaises ainsi que les troupes malgaches d’un pseudo-gouvernement conservé jusqu’en 1896. Au terme d’affrontements diffus, de batailles arrangées, d’assauts de villes (Antsirabe, Ambatondrazaka) et du blocus de Tananarive, la rébellion s’achève par la reddition des chefs « Menalamba » ou leur exécution. Le conflit fragilise l’installation des Français et leur projet de conquête de l’île, en reportant les échéances victorieuses au début du siècle. Depuis, le mouvement « Menalamba » fait l’objet d’une remémoration avantageuse au sein des courants nationalistes malgaches. L’auteur, par une démonstration fondée sur une documentation élargie aux sources anglaises, françaises et malgaches, rappelle que cette rébellion, que l’on a souvent présentée comme un soulèvement antifrançais, est d’abord une guerre civile.
Les trois premiers chapitres mettent en place les fondements historiques des clivages politico-religieux lesquels, en Imerina, remontent à la fin du XVIIIe siècle et sont exacerbés par le déclin du royaume de Madagascar, puis par l’invasion française. C’est dans la tradition de collaboration et de résistance à l’autorité royale (la dynastie d’Andrianampoinimerina), puis à la centralisation du royaume au profit d’un groupe d’oligarques, sous la direction du Premier ministre Rainilaiarivony, qu’il faut chercher une des premières causes de la révolte. À cette combinaison mettant en jeu les rouages sociaux s’ajoute la référence religieuse : la conversion au protestantisme de la hiérarchie politique en 1869 a poussé dans la marginalité les partisans du maintien des cultes royaux ancestraux ainsi que les catholiques. Enfin, la décrépitude de l’État malgache, sensible dès 1880, favorise la désobéissance civile qui prend autant l’aspect d’un banditisme rural aux marges de l’Imerina, que celui de l’insoumission des provinces périphériques ou d’une déchristianisation latente.
Les trois chapitres suivants (l’insurrection stricto sensu de décembre 1895 à octobre 1896, la guerre des sectes et l’extension de la révolte) permettent à l’auteur de développer sa thèse du conflit civil et politico-religieux et surtout de faire prévaloir l’extrême ambiguïté du phénomène. Si le mouvement « Menalamba » a revêtu des aspects antichrétiens, il n’en demeure pas moins que nombre de ses membres, notamment parmi ses dirigeants étaient des convertis. De même, les régions les plus oppressées par l’ancien gouvernement n’ont pas compté parmi les zones les plus rebelles.
Les catégories de pensée usuelles (l’opposition catholique/protestant), les références en passe de devenir des clichés tombent face à l’analyse. En premier lieu, en privilégiant la dimension du conflit confessionnel, sur lequel se greffe une résurgence de la culture traditionnelle, l’auteur minimise — à juste titre — le face- à- face franco-malgache, tel que les sources officielles (françaises) et l’historiographie (française) le laissaient croire. En second lieu, en traquant les rivalités internes en Imerina, l’auteur fait apparaître des clivages discordants et des systèmes d’alliances croisées entre des groupes, des localités, des régions qui restituent au mouvement « Menalamba»son aspect d’implosion politico-sociale. Enfin, en élargissant l’étude à d’autres populations et régions insurgées entre 1895 et 1899, que ce soit les « Vorimo » dans l’Est en 1895, le Nord-Ouest en 1897-1898 ou la révolte des « Tanala » du Sud-Est à la même époque, l’auteur fait ressortir les composants de « l’esprit insurrectionnel » : les réactions anti-merina et antichrétiennes et la résistance à l’envahisseur qui peuvent s’imbriquer dans certains cas.
Cependant, le mouvement « Menalamba » de l’Imerina conserve sa spécificité. Défini (p. 182) comme un mouvement antichrétien et provincial au cœur du royaume de Madagascar et sur ses marges, il est unique comme mouvement de défense de la cause du royaume traditionnel (p. 130), expliquant alors que les protestants malgaches se sont trouvés du côté des Français et non des patriotes « Menalamba ».
Situation largement occultée sinon oubliée par les nationalistes. Publié pour la première fois en 1985, sous le titre The Rising of the Red Shawls, ce livre a marqué une étape dans la recherche sur l’histoire de l’île, bousculant des certitudes admises, reconsidérant les a priori paralysants d’une historiographie à l’aune soit des aspirations indépendantistes, soit des expériences socialistes. On peut considérer qu’il a ouvert la voie à des relectures indispensables, poursuivies autour de l’esclavage (colloque de 1996, Antananarivo) et de la rébellion de 1947 (colloques de 1997, Antananarivo et Saint-Denis). Enrichi de cartes, d’une chronologie, d’une bibliographie, d’un index des noms et d’une annexe biographique sur les principaux acteurs de cette époque, ce livre est une excellente introduction à l’histoire contemporaine de Madagascar. Axé sur une interprétation politico-religieuse du phénomène « Menalamba », il a été enrichi depuis par une approche économique.
Recueillis par Maminirina Rado



