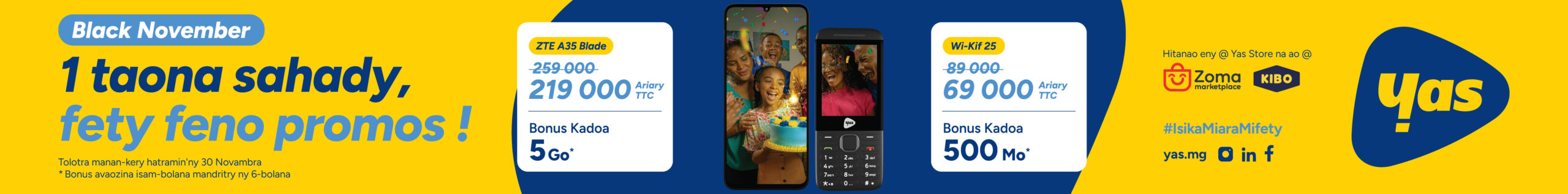Le poète et universitaire Thierry Sinda vient de faire paraître aux éditions du Petit Pavé un numéro spécial de la revue « Délits d’encre », consacré au poète guyanais de la négritude Léon-Gontran Damas. A cette occasion, nous l’avons rencontré pour connaître la part de Madagascar dans le mouvement littéraire de la négritude dans lequel se sont illustrés Jean-Joseph Rabearivelo, Jacques Rabemananjara, et Flavien Ranaivo. Interview.
Qu’est-ce que la négritude exactement ?
La négritude est un mouvement culturel d’intellectuels colonisés de l’Empire colonial français, lesquels se rencontrent dans la métropole parisienne, entre 1921 et 1960, date des indépendances africaines. Ces écrivains venaient des quatre coins des colonies françaises : Haïti, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Sénégal, Côte d’Ivoire, Mali, Congo, Guinée, Madagascar. Ils ont réuni leur force, leur culture, et leur diversité pour rétablir la dignité de l’homme noir et métissé et de leur culture.
Pourquoi ce mouvement historique a-t-il pris le nom de « négritude » ?
Il ne vous a pas échappé que le « nègre » n’existe pas. Il existe comme je vous l’ai dit des Sénégalais, des Congolais, des Malgaches, etc. Le « nègre » est une invention de l’Homme blanc, pour rassembler sous le même vocable dépréciatif tous les noirs et métissés ressortissants des anciennes colonies françaises. Ces écrivains, armés de courage, redressaient par leurs écrits coruscants les torts du colonisateur, qui avait mis à mal et nié leur histoire, leur religion et leur culture. Le mot « négritude » est un mot heureux inventé par le Martiniquais Aimé Césaire en 1939, avant de devenir, en 1948, un mouvement, avec le manifeste du Sénégalais Léopold Sédar Senghor : « Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française. »
L’article majeur de la revue « Délits d’encre » nº26 est : « Léon-Gontran Damas : sève créole et négritude parisienne ». Pourrait-on dire de la même manière pour nos auteurs malgaches : « sève malgache et négritude parisienne »?
Oui tout à fait, puisque chacun de ces écrivains colonisés ont été forgés par une culture et une histoire régionale, qu’ils apportent au mouvement parisien de la négritude. C’est ce que Jacques Rabemananjara appelle l’épiphanie : « D’abord entre nous (colonisés) puis entre nous et le reste du monde (les colonisateurs) ». On ne peut pas étudier valablement l’apport de la négritude de Jacques Rabemananjara sans la mettre en rapport avec la révolte anti-coloniale de mars 1947. De même, on ne peut pas étudier la négritude de mon père Martial Sinda sans la mettre en rapport avec le matsouanisme congolais qui a défié la colonisation française dans les années 1920. Flavien Ranaivo et Jean-Joseph Rabearivelo apportaient à l’épiphanie de la négritude parisienne : « La Renaissance de l’âme malagasy » en français.
Propos recueillis par Patrice RABE