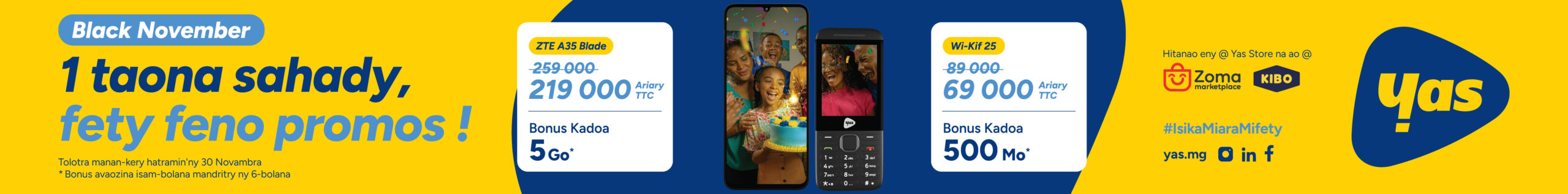Le projet de prévention et de réponses aux violences basées sur le genre constitue un appui du Royaume de la Norvège dans la lutte contre ce fléau à Madagascar. L’autonomisation économique de la femme en est l’un des facteurs clés.
Faim, inexistence d’activités génératrices de revenus ou encore rareté de l’eau, des situations qui deviennent intenables pour de nombreux foyers du district d’Ampanihy, région Atsimo-Andrefana. Ces situations engendrent « une hausse considérable des violences basées sur le genre, notamment économiques » d’après les explications de Voahangy Razafimamonjy, intervenante sociale auprès du Centre d’écoute et de Conseils juridiques du même district. Propos confirmés par Mevasoa, mère de famille qui fait savoir que :« les couples s’énervent facilement et les disputes font partie du lot quotidien des foyers. Les tensions peuvent facilement dégénérer en violence physique. Et le fait pour l’homme de ne pas ramener de l’argent pour les besoins du foyer en est la cause». En effet, du mois de janvier au mois de juillet 2021, le Centre d’écoute et de Conseils juridiques d’Ampanihy a «enregistré 149 cas dont les 49 observés ont été recensés entre janvier et mars». L’année 2020 ayant enregistré 178, «l’on pourrait s’attendre à une hausse du nombre des cas d’ici fin 2021», si l’on s’en tient toujours aux explications de Voahangy Razafimamonjy. Avant de préciser que «la situation de sécheresse qui sévit actuellement dans le district d’Ampanihy en serait probablement la cause car elle impacte de façon considérable sur les revenus des ménages».
Espoir. Si les violences basées sur le genre constituent des faits sociaux dans beaucoup de régions et districts du pays, y compris Ampanihy, le tableau n’est toutefois pas tout noir. Des femmes qui en ont été victimes arrivent à survivre et à se (re)prendre en main. Le cas de Haovasoa Angelina, mère de trois enfants qui a été abandonnée par son mari en est un exemple parmi tant d’autres. Faisant partie des vingt femmes ayant bénéficié d’une formation en coupe et couture ainsi que de kits de démarrage dans le cadre du projet de prévention et de réponses aux violences basées sur le genre dans la région Atsimo-Andrefana, Haovasoa Angelina dispose actuellement d’une activité qui assure, tant bien que mal, les besoins de sa famille. «Je ne travaillais pas avant et je n’avais aucune perspective. Après la formation organisée à Toliara, cela fait six mois que j’exerce en tant que couturière. Ce qui me permet de gagner 15 000 Ar à 20 000 Ar par jour quand les choses marchent bien». L’entretien avec Haovasoa Angelina a également permis de savoir qu’elle a étendu son activité. «Avec les économies que j’ai pu mettre de côté depuis l’année 2020, je me suis mis à vendre de la friperie. Ce qui jusqu’ici a contribué à améliorer ma vie comparée à celle d’avant», avance avec fierté cette mère de famille.
José Belalahy