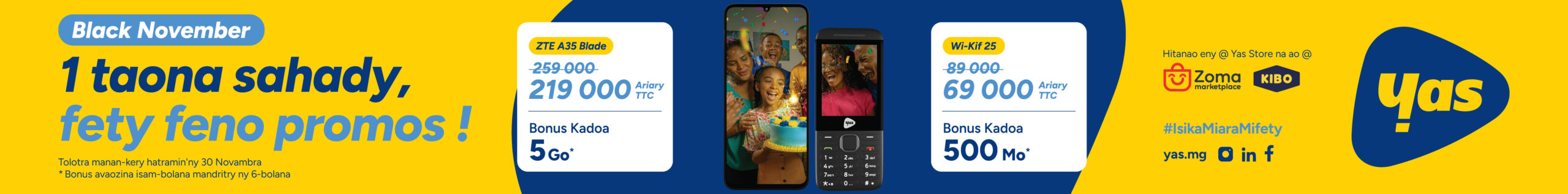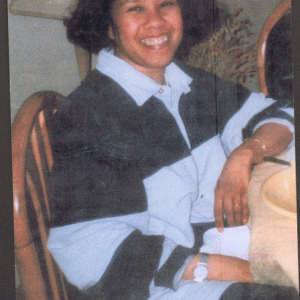
La littérature malgache de langue française est très peu connue des spécialistes de la littérature francophone qui parlent plus souvent des écrivains maghrébins, haïtiens ou africains. Elle possède pourtant des auteurs dont les œuvres montrent leur richesse de pensée. Michèle Ratovonony a réussi à montrer leur manière de s’approprier la langue française sans pour autant être asservis par elle. Michèle Rakotoson, Charlotte Rafenomanjato, Raymond William Rabemananjara et Michel Françis Robinary sont des écrivains qui ne renient pas leur malgachéité et traitent de thèmes résolument malgache. Cet essai que la jeune femme a écrit lorsqu’elle était professeur et chercheur à l’université de Montréal a eu un grand retentissement. La maladie ne lui a pas permis de terminer le travail de réflexion et de recherches qu’elle avait entrepris.
« Ecrivain bilingue dans un milieu de diglossie », cette expression que l’auteur a empruntée à Elisa Rafitoson définit parfaitement l’écrivain malgache d’expression française qui, quotidiennement, jongle avec le malgache et le français. L’utilisation de la langue française lui permet d’exprimer certaines idées ou de décrire certaines situations ou certaines notions passant difficilement en malgache. Il affiche un imaginaire ancré dans le terroir. Michèle Ratovonony a choisi de s’intéresser à la littérature romanesque et aux œuvres de six auteurs en particulier. Son objectif était de voir comment le romancier malgache d’expression française assumait son métissage en s’appropriant la langue française.
Identité malgache et histoire. Une présentation succincte de Madagascar et de son histoire, permet de se familiariser avec les fondements de la culture malgache, ses coutumes, ses rites et ses croyances. L’utilisation de la langue française est une réaffirmation ou plutôt une consolidation de son identité. « Le français a depuis longtemps perdu la rudesse du masque et l’insolite de l’accent étranger »pour beaucoup de Malgaches et plus spécialement les écrivains. On ne peut plus parler d’aliénation. « Le français dégorgé de sa blancheur va devenir une arme miraculeuse chargée d’assurer la conquête de l’identité ».
L’auteur va, à travers les romans de différents auteurs, développer des thèmes qui sous tendent le fonctionnement de la société malgache.
Le rêve et la mort dans « Le bain des reliques » de Michèle Rakotoson. L’écrivaine permet à travers ce récit romanesque de focaliser l’attention sur la crise, le rêve et la mort. Le héros Ranja traverse des situations toutes plus étonnantes les unes que les autres qui permettent d’explorer tous ces thèmes.
La transgression dans « Au seuil de la terre promise » de Michel Robinary. Le texte nous dit que l’auteur s’inscrit dans la veine poétique. Le lyrisme fait partie intégrante de la personnalité du Malgache. L’analyse du style littéraire de Robinary permet de parler d’un cachet quelque peu baroque, reflet d’une certaine liberté de l’écrivain refusant les carcans de l’édifice littéraire. « Au seuil de la terre promise » transgresse les conventions littéraires pour pratiquer une esthétique, celle de l’incongruité.
Le dialogue culturel dans « Le pétale écarlate » de Charlotte Rafenomanjato. L’écrivaine plonge le lecteur au cœur d’un univers malgache ancré dans le terroir. « Tout dans le roman participe du souci constant du dialoguisme ». Le récit tient à la fois du roman d’amour, du roman de mœurs et conte fantastique. Le thème de la communication entre le monde des vivants et l’au-delà est amplement développé.
L’aïeule dans « Dadabe » de Michèle Rakotoson. Le grand-père joue le rôle principal dans « Dadabe ». La grand-mère est le pendant de son époux. Le couple fonctionne comme une personne à double face. « Dadabe » est médecin et décide de s’installer à la campagne. Son arrivée sur place va constituer un véritable bouleversement. Il attise la rancœur des paysans en voulant piétiner la tradition.
L’imaginaire du départ et de l’exil chez Michèle Rakotoson. C’est dans « Henoy, fragments d’écorce » et « Elle au printemps » que l’on trouve ce thème. La crise qui mine Madagascar de soixante-dix jusqu’à aujourd’hui a fait de la grande île un pays sans avenir, un pays qui part en lambeau. Il y a l’idée du départ en se donnant la mort, chose impensable pour beaucoup d’entre nous, mais il y a le départ vers un autre endroit, un autre pays pour trouver une vie meilleure. C’est parfois le désenchantement.
L’homme debout et le peuple dans « Chronique d’une saison carcérale en Lémurie » de Raymond William Rabemananjara. C’est un récit autobiographique aux relents quelque peu polémiques. Le récit se passe dans les années soixante-dix et la grande île est appelée Lémurie. L’auteur parle d’un pays pittoresque. Il ne manque pas d’humour. Il a une aptitude à ne rien prendre au tragique voire à prendre la partie d’en rire. Il est arrêté, on perquisitionne à son domicile. Il a une façon toute naturelle de se dissocier de ce qui se passe. Une fois signé le procès verbal dressé au ministère de l’intérieur, il comprend qu’il est accusé de complot. Il ne se laisse pas démonter. « J’étais avec moi-même. C’était une force », affirme-t-il. Au fil des heures, il découvre la bienveillance des subordonnés. « Ce sont tous des gens simples », constate-t-il.
Patrice RABE