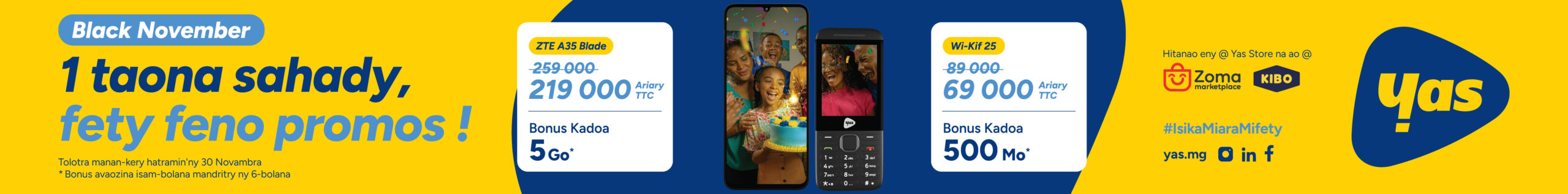Honoré Rakotomanana, président du Sénat et non moins ancien juge international, dévoile le bien-fondé du dialogue politique dans la gestion du pouvoir. Interview exclusive.
Honoré Rakotomanana, président du Sénat et non moins ancien juge international, dévoile le bien-fondé du dialogue politique dans la gestion du pouvoir. Interview exclusive.
Midi Madagascar (MM). Que pensez-vous de l’appel au dialogue lancé par le président de la République et la « Justice et Paix ?
Président du Sénat (PS). C’est impératif dans le contexte présent. L’importance du dialogue dans la gestion du pouvoir est une source d’efficacité dans la mise en œuvre des Politiques de développement qui a comme préalable la restauration de la paix sociale.
Pour ma part, il est un devoir de ne pas rester les bras croisés. Il faut tout faire pour faciliter le dialogue entre les tenants du pouvoir, les politiciens de l’opposition de même que les journalistes qui exercent, eux aussi, un pouvoir sur l’opinion publique. Il y a aussi le dialogue Public-Privé : un concept qui vise à tenir compte des avis des investisseurs tant nationaux qu’étrangers. Cet appel s’adresse d’une manière générale à la population.
MM : Quelle méthode d’approche préconisez-vous ?
PS A mon avis, les composantes éthiques et morales acquièrent nécessairement une dimension primordiale pour niveler autant que possible la divergence de points de vue sur les plans conceptuels, politique et technique de la gestion du pouvoir. Et c’est le principal aspect que je vous parle en substance ici en quelques phrases.
J’ose dire que le vrai problème rencontré par les populations les plus pauvres, car elles sont les plus nombreuses, c’est avant tout la survie. La hantise de la mort dans ces groupes vulnérables de la population réduit les chances de succès de dialogue constructif basé sur des principes communément admis dans les sociétés dites organisées ou ordonnées. Si les acteurs politiques et les organisations de la société civile n’ont pas de vision commune sur le développement, le populisme l’emportera sur le réalisme et le bon sens. Ce qui entraine un cycle d’incompréhension et d’instabilité politique. La problématique morale et éthique de la pauvreté s’inscrit dans ce contexte, accentuée, hélas, par les crises politiques chroniques et devenues cycliques.
A cet égard, j’exhorte les acteurs politiques et les organisations de la société civile à maintenir le dialogue et à rejeter toute tentative de manipulation de l’opinion publique visant à provoquer une nouvelle crise politique.
Une telle posture nuit à l’unité nationale. Nos partenaires de développement sont sensibles à l’instauration du dialogue à tous les niveaux pour la promotion du développement et la lutte contre la pauvreté.
MM : Mais certains politiciens disent que la crise politique est un « mal nécessaire ».
PS : Eh bien, ils ont tord ! C’est une ignominie que d’accepter une telle fatalité ! La trajectoire politique de Madagascar révèle que l’instabilité politique a toujours des retombées négatives sur la situation économique et le niveau de vie de la population. La crise politique de 1991 a provoqué un taux de croissance négatif de l’ordre de -6,3% contre 3,1% en 1990. Durant la crise de 2002, le taux de croissance économique a atteint un niveau abyssal de -12,7%, contre 6 % en 2001. Le taux de pauvreté est passé de 69,6% à 80,7% entre cette période.
De même qu’en 2009, le PIB a enregistré une croissance négative de -4,1% et le taux de pauvreté s’est aggravé en 2010. Donc, je réfute le fatalisme de certains. Il faut arrêter de jouer au pyromane.
MM : Croyez-vous que le régime en place a la possibilité de réduire la pauvreté ?
PS : C’est son devoir de le faire. La lutte contre la pauvreté est un processus long et complexe. Mais l’histoire du développement montre que la tendance à la paupérisation peut être renversée, comme on le voit au Rwanda ou en Corée du sud et ailleurs. Le gouvernement ne ménage pas ses efforts pour sortir Madagascar de la pauvreté. Mais bien entendu, les impacts sur le niveau de vie de la population ne seront ressentis que sur le moyen voire le long terme.
MM : Est-ce que le dialogue reste toujours pertinent par rapport à la pratique politique malgache ?
PS : Privilégier un dialogue politique entre les acteurs est la meilleure solution pour éviter une éventuelle crise politique et ses conséquences néfastes. Le dialogue est en tout cas mon maître-mot. Mais le dialogue n’est pas une vache sacrée ni un sujet tabou et encore moins une recette miracle ! C’est une méthode pour trouver un consensus large, pour amenuiser la haine et éviter la violence. Le dialogue est un mode de régulation souple et efficace dans la recherche du meilleur compromis. Le dialogue permet d’éviter l’affrontement et de renforcer la paix sociale.
Je crois que les acteurs politiques, quelles que soient leurs convictions ou penchants politiques, doivent accepter le dialogue sur la base des règles d’une bonne cohabitation sociale et au nom du Fihavanana.
MM : D’après vous qu’est-ce que la démocratie ?
PS : C’est vous et moi et les 20 millions de malgaches vivant sur un même espace géographique qu’est Madagascar, désirant instaurer des règles visant à défendre l’intérêt général sans nuire à l’intérêt individuel. Territoire, population, puissance publique : ce sont les ingrédients à combiner pour adopter des politiques publiques répondant au nécessité du développement.
La démocratie est une grâce accordée par la « majorité » à la « minorité ».
La démocratie, c’est de ne pas critiquer systématiquement les actions menées par le pouvoir. La démocratie, c’est aussi prêter une oreille attentive aux aspirations de toutes les catégories de population.
La démocratie, c’est savoir contenir les émotions et mesurer les langages et ne pas abuser de la liberté d’expression. Dois-je souligner que trop de démocratie tue la démocratie. Et c’est à juste titre que l’article 14 de la Constitution parle « d’opposition démocratique ». Faut-il rappeler que l’alternance démocratique est une valeur universelle car personne n’est propriétaire des voix du peuple. En démocratie, la souveraineté appartient à l’universalité des citoyens. C’est eux qui décident du modèle de démocratie qui leur convient. L’expression de cette souveraineté doit s’inscrire dans les réalités historiques, culturelles et sociales de chaque peuple. C’est à quoi nous sommes tous tenus de faire depuis 56 ans de régime républicain.
MM : Avez-vous des mots à dire sur la contestation des populations locales contre les investisseurs étrangers ».
PS : Si vous faites allusion à ce qui se passe à Soamahamanina ou à Mandritsara, il ne faut pas prendre des raccourcis qui vont alimenter les polémiques à n’en plus finir. Comme je l’ai dit, l’intérêt individuel ne doit pas nuire à l’intérêt général et inversement. La mondialisation étant, chaque pays a besoin d’investissements étrangers. Les droits des nationaux autant que des étrangers sont les mêmes en matière d’investissement et d’accès aux ressources du pays dans le cadre des lois en vigueur à Madagascar. En tant qu’ancien magistrat, la primauté des lois doit toujours l’emporter sur les sursauts d’humeur, les clichés et les préjugés. Les cahiers de charges sur les investissements dans les secteurs concernés sont destinés à clarifier les responsabilités des uns et des autres. Et je pense que la Loi sur les grands investissements avec d’autres lois sur les ressources minières prévoient des mesures pour promouvoir les bonnes pratiques et défendre les intérêts des uns et des autres. Le principe gagnant-gagnant devrait guider les résolutions de conflits d’intérêts.
Recueillis par Antsa R.