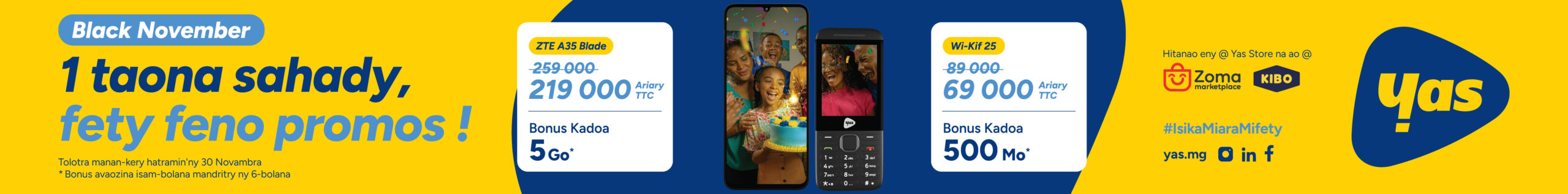Dans l’Androy, ces petites taches blanches que l’on retrouve figées sur les tiges de manioc ou collées aux feuilles de figuier n’ont rien d’anodin. Les cochenilles sont aujourd’hui si répandues à un tel point qu’elles ont toujours fait partie du paysage. Pourtant, leur prolifération actuelle raconte une histoire plus vaste : celle des plantes qui voyagent malgré elles, des routes marchandes, de la colonisation et des équilibres écologiques brisés. Avant le XIXᵉ siècle, les cochenilles locales existaient bel et bien, mais elles vivaient dans un système où la végétation, les prédateurs naturels et les pratiques agricoles traditionnelles maintenaient un fragile équilibre. Dans cette région de sécheresse chronique, chaque plante et chaque insecte trouvait sa place. Puis vinrent les navires, les commerçants, les missionnaires — chacun transportant des plants de manioc, de figuier, de coton, ou d’autres espèces utiles. Ces végétaux abritaient parfois des cochenilles exotiques invisibles, collées sous les feuilles ou glissées dans les fibres. Les cochenilles ne voyagent jamais seules ; ce sont les humains qui leur ouvrent les routes du monde. Au début du XXᵉ siècle, la colonisation française accéléra brutalement ce mouvement. En cherchant à restructurer l’économie du Sud malgache autour du coton, du sisal ou du manioc industriel, l’administration déplaça massivement des boutures, parfois infestées. Les défrichements intensifs, la monoculture et l’introduction de variétés étrangères ont créé un environnement idéal pour les parasites : peu de diversité végétale, peu de prédateurs, beaucoup de stress hydrique. Dans ce contexte, les cochenilles introduites trouvèrent dans l’Androy une terre sans résistance. Elles se sont multipliées sur le manioc (notamment Phenacoccus manihoti), sur les figuiers, sur certaines euphorbiacées et sur les plantations de sisal. Les premières pertes agricoles documentées liées à ces parasites datent de la période coloniale. Lorsque les sécheresses étaient plus sévères au milieu du XXᵉ siècle, les cochenilles profitèrent d’un phénomène connu : les plantes stressées sont beaucoup plus vulnérables. Les pesticides utilisés par les services coloniaux aggravèrent la situation : en voulant éliminer le parasite, ils tuèrent aussi les insectes prédateurs, permettant aux cochenilles de recoloniser encore plus vite les cultures. Aujourd’hui encore, les infestations de cochenilles dans l’Androy portent une part de cet héritage historique. On ne peut pas dire que ces parasites aient été « génétiquement manipulés » — la génétique moderne n’existait pas à l’époque — mais leur présence résulte clairement des trajectoires économiques et agronomiques imposées à la région. Face à elles, les communautés tandroy ne restent pas passives. Elles puisent dans des savoirs anciens pour concocter des remèdes : cendre chaude pour étouffer les colonies, décoctions amères de plantes locales, associations végétales pour limiter les risques. Cette lutte quotidienne, patiente et inventive, montre que les cochenilles ne sont pas qu’un insecte nuisible : elles sont aussi la preuve vivante de la capacité humaine à s’adapter, à comprendre et à protéger ce qui fait son monde.
Sources :
- Rashid, M. A. et al. (2016). Occurrence and distribution of cassava mealybug (Phenacoccus manihoti) in Madagascar. Journal of Insect Science.
- Kull, C. (2004). Isle of Fire: The Political Ecology of Landscape Burning in Madagascar. University of Chicago Press
Recueillis par Maminirina Rado