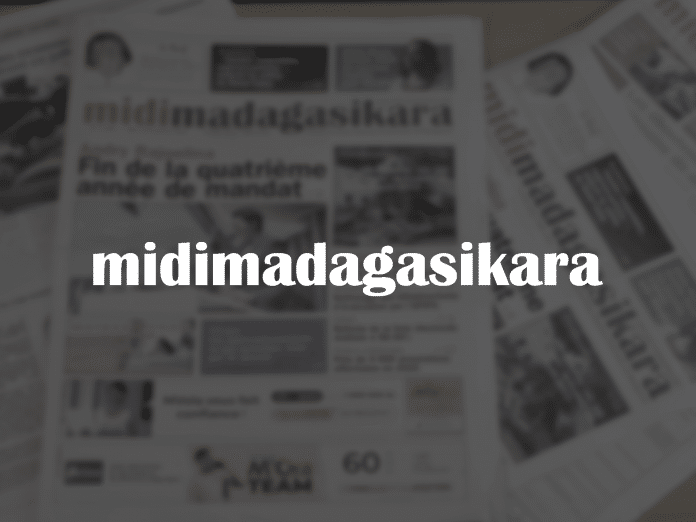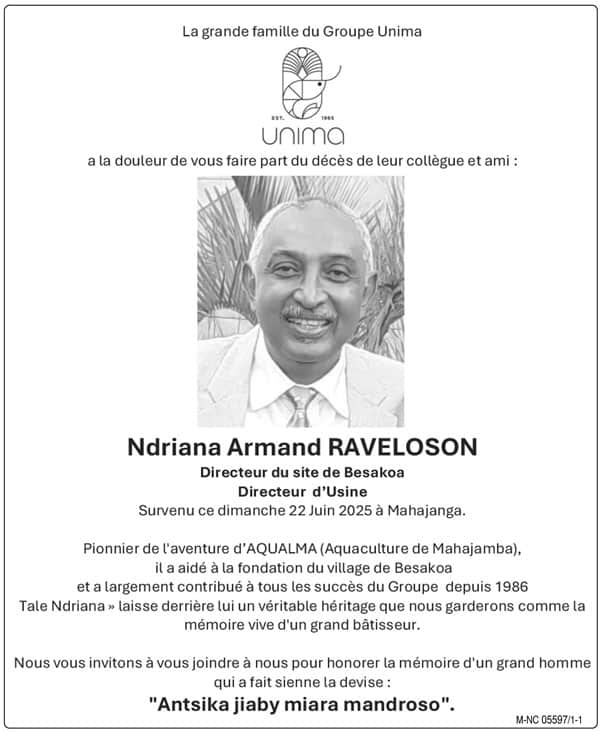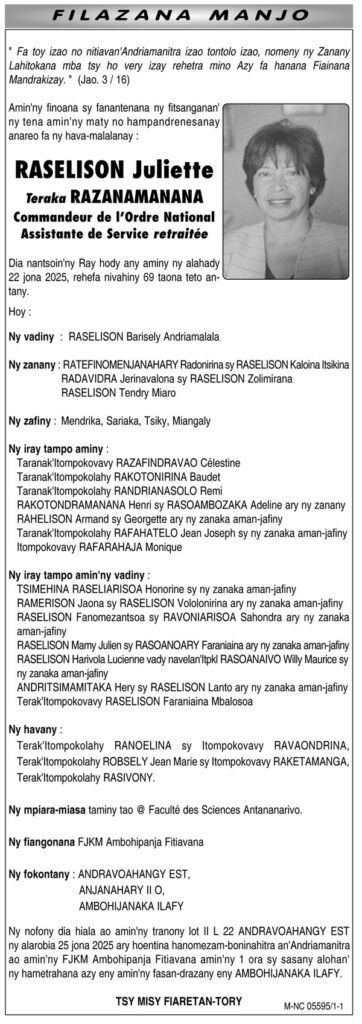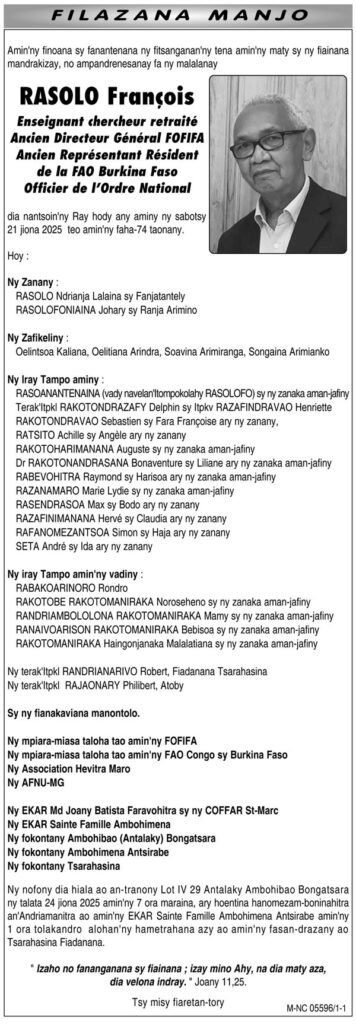Alors que la Grande île s’apprête à célébrer le 65e anniversaire de son indépendance, Harimino Elisé Asinome, Docteur en Histoire contemporaine, Enseignant-chercheur à l’Université de Tuléar, Chercheur associé à l’Institut Ralaimongo d’Histoire et d’Etudes politiques, a effectué une rétrospective de l’économie des premières années de cette indépendance.
Suite à la Seconde Guerre mondiale, l’économie de Madagascar se retrouve confrontée à une pénurie de devises ainsi qu’à un manque d’approvisionnements en provenance de la métropole pour ses besoins d’importation. Cette situation a conduit à une inflation soutenue dans l’ensemble de la Grande-Ile. En réponse au bouleversement économique, la France a initié plusieurs réformes, notamment la transformation du système de traite, dans l’ensemble de ses territoires d’outre-mer.Dans les années 1940-1950, l’afflux massif des capitaux publics (Fonds d’investissement pour le développement économique et social ou FIDES), les travaux d’infrastructure, la naissance de l’industrialisation, la modernisation de l’agriculture, la reconversion du capital marchand en capital productif, ont constitué des éléments clés de mutation, s’accompagnant de changements sociaux significatifs dont les plus notables sont: l’explosion démographique, les progrès de la scolarisation et l’intensification du phénomène d’exode rural.
Legs colonial et chargé des fonctions d’un nouvel Etat
À l’aube de l’indépendance, les critères du sous-développement sont réunis pour la Grande-île dont le tableau paraît généralement assez sobre selon les analyses de Césaire Rabenoro dans sa thèse de doctorat: «les techniques agricoles sont encore primitives, l’industrie n’est que embryonnaire, le revenu per capita est bas, l’essor démographique est réel.»
Au cours de cette période, d’autres faits marquants de l’économie du pays comprennent la rupture du cycle d’accumulation de la rente et la raréfaction des ressources extérieures. Ces phénomènes sont, d’après l’économiste Gilles Duruflé, à l’origine de la crise économique que connaissent les anciennes colonies de la France. Ces pays attestent « l’épuisement du modèle néocolonial de croissance» dont, d’après le même auteur, les principaux traits sont les suivants:
– le legs, au moment de l’indépendance, d’une économie structurée sur un système de traite, caractérisée par la production et l’exportation de produits primaires, surtout d’origine agricole.
– le développement, au lendemain de l’indépendance, des activités industrielles axées sur la substitution des importations, souvent bénéficiant de fortes protections, le plus souvent sous contrôle étranger.
– le lancement de vastes programmes de développement rural pour favoriser l’expansion et la diversification agricoles.
– l’importance grandissante que le nouvel État occupe dans l’économie, prenant en charge les fonctions essentielles au développement telles que l’administration, les infrastructures, l’éducation et la santé.
En effet, au début de l’indépendance, l’économie malgache demeure sous l’emprise de la puissance étrangère. « Sous-développée, cette économie est dépendante tant vue de l’intérieur que par rapport à l’extérieur. » L’industrie balbutiante est contrôlée par des entreprises françaises. Les étrangers détiennent la majorité du capital et sont les maîtres des décisions. Le secteur du commerce est dominé principalement par les sociétés françaises d’import-export au stade du gros, alors que les Indiens et les Chinois se partagent le marché du demi-gros et se font aussi détaillants.
En outre, la dépendance vis-à-vis de la France et du monde occidental est particulièrement nette en termes des échanges extérieurs de la Grande-Ile. En 1960, les importations en provenance de la « zone franc », pratiquement de la France, représentaient 76,3% en valeur. Quant à l’exportation, la destination des produits malgaches n’est pas moins révélatrice des liens étroits sinon exclusifs de son commerce avec l’occident. Toujours en 1960 la zone franc, la France en pratique, absorbe 73% des produits malgaches.
Dans le contexte de la mutation du système productif français comme la concentration et la centralisation du capital, l’internationalisation de l’échange, de la production et du financement, les flux commerciaux avec les anciennes colonies se sont réorientés vers des produits plus capitalistiques c’est-à-dire les biens d’équipement et les biens intermédiaires, tout en perdant de leur importance relative. L’ancien capital colonial s’est reconverti. La Banque d’Indochine s’est redéployée vers les espaces industriels ; les firmes multinationales françaises se sont orientées vers les nouveaux pôles d’accumulation. Les grandes sociétés de traite se sont désengagées d’une partie de leurs activités commerciales et se sont reconverties vers le grand commerce urbain ou vers les activités industrielles ou minières. D’où la présence des firmes françaises sur les territoires malgaches, leurs sièges sociaux ou bureau de représentations se trouvent généralement dans la capitale, avant d’installer les antennes en provinces. Tout ceci met donc en évidence que les vestiges du pacte colonial reposent principalement sur le maintien des anciens territoires d’outre-mer en tant que pourvoyeurs de matières premières destinées aux industries des anciennes métropoles.
Vers la restructuration de l’économie malgache
L’indépendance politique une fois acquise, c’est vers l’indépendance économique que tendent naturellement les efforts des jeunes Etats. En mars 1961, dans une conférence de presse sur la politique économique de son gouvernement, Tsiranana soulève la question de l’indépendance économique pour laquelle « la nation malgache doit compter sur elle-même ». Il lance le principe des actions « au ras du sol », petites opérations réalisées avec le concours de la population, à effet immédiat. C’est la guerre déclarée contre le sous-développement sous son triple aspect : la faim, ou plus exactement la malnutrition, la maladie et l’ignorance.
Dans le domaine du commerce extérieur, le gouvernement malgache vise à diversifier ses partenaires. Les responsables de la Première République malgache sont conscients des limites de l’indépendance économique à l’échelle mondiale de l’interdépendance des économies d’un pays à l’autre. L’État malgache a aussi besoin de l’intervention française pour la mise en œuvre de sa politique de développement. En effet, le recours aux services d’aides financières de la France s’avère nécessaire pour le pays, tout en manifestant délibérément l’intérêt de rester dans la zone franc.
Afin de donner un nouveau souffle à l’économie malgache de l’après colonisation et affecté par la grande inondation de mars 1959, le gouvernement Tsiranana produit en 1962, un document détaillant certaines options de plan de développement. Il faut donc attendre quelques années après l’Indépendance pour que le pays dispose d’un véritable plan que les Malgaches peuvent s’approprier et maîtriser depuis la conception à la mise en œuvre. Il s’agit donc du premier et véritable plan malgache dont l’élaboration est précédée d’une étude plus ou moins poussée.
Avant son lancement, il fait l’objet d’une étude publiée en octobre 1960 par le Secrétariat d’État aux relations avec les États de la Communauté. Le résultat est présenté dans une brochure sur la situation de l’économie de la République malgache avec des données statistiques. Sous l’appellation de « le livre blanc de l’économie malgache », ce document revêt d’un intérêt capital pour la compréhension de la situation économique malgache au seuil de l’Indépendance. D’ailleurs, ce nouveau plan n’est qu’une passerelle entre les programmes de développements établis dans les années 50, suite à l’autonomisation du territoire d’outre-mer.
Le document renferme une sorte d’inventaire et présente l’évolution de l’économie malgache de 1950 à 1960. Il évoque également les caractéristiques de la société malgache. Il se veut une force de proposition dans ce contexte de responsabilité malgache par rapport à la gestion du pays. Ce document présente des idées sur l’orientation générale du Plan de développement, sur le programme d’aide extérieure pour 1960 et sur les perspectives de l’aide française. Dans ce document, sont donc fixés les objectifs prioritaires de l’action gouvernementale, les options fondamentales en matière économique, objectifs et options qui inspirent le 1er plan quinquennal malgache (1964-1968). Le plan vise comme objectif l’accroissement de la part des investissements dans le PIB, de 14 % à 21 % de 1960 à 1973, et adopte une orientation vers une économie d’import substitution.
Bref, à Madagascar les principes de développement de l’après Indépendance, durant la Première République, consistent à favoriser une économie préindustrielle. Il s’agit de doter à la Grande île des infrastructures de base afin qu’elle puisse fournir les produits agricoles et industriels indispensables à l’exportation.
Dossier réalisé par Julien R.