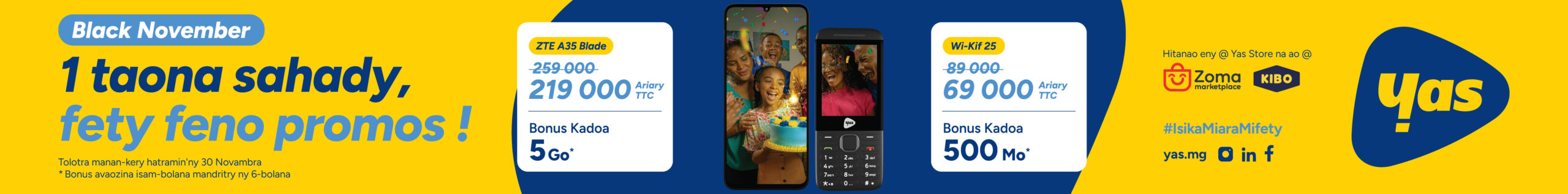Les règlements des cas de pollution marine par déversement d’hydrocarbure se font actuellement à l’amiable sur la Grande Île, faute d’organisme capable de juger et de sanctionner les responsables des faits.
Le cas du naufrage du navire Mykonos, en 2016 à Faux Cap, rappelle le manque d’institution capable de statuer sur les cas de pollution marine par déversement d’hydrocarbure à Madagascar. Une situation qui n’est pas bénéfique pour le pays, étant donné que pour ce cas précis, les règlements se sont faits à l’amiable, sans pour autant que la région concernée n’en ait suffisamment profité. Des données recueillies auprès de l’OLEP, ou Organe de Lutte contre l’Evénement de Pollution Marine par les hydrocarbures, font savoir que « la ratification par Madagascar, en 2011, des conventions relatives à la responsabilité civile sur le déversement d’hydrocarbure, la convention sur le fond international des hydrocarbures, et la convention portant coopération en matière de lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures en 2001, impose la mise en place d’un tribunal compétent capable de juger les cas ». Devant être de la responsabilité du ministère de l’Environnement et du Développement Durable, en collaboration avec le ministère de la Justice, « la mise en place devrait se faire suivant le principe du pollueur-payeur ». Les données de l’OLEP font également savoir que « les jugements et décisions pris auprès du tribunal à mettre en place, sont valables au niveau de tous les Etats parties aux conventions en question ». Une source fiable de noter que « des efforts ont été menés en 2016, sans pour autant avoir des résultats concrets jusqu’ici ». La source de renchérir « un magistrat a été dépêché par le ministère de la Justice dans le cadre de la mise en place du tribunal. Aucune information n’a depuis été sortie concernant cette démarche ».
Constants. Avec ses 5 000 km de côtes, Madagascar s’expose continuellement à des risques de déversement d’hydrocarbures. En effet, les données recueillies auprès de l’OLEP démontrent que « près de 7 000 navires parcourent chaque année le Canal de Mozambique et de l’Océan Indien ». Les mêmes données de préciser que « huit navires qualifiés de « ultra large » – pouvant transporter 300 000 à 500 000 tonnes de marchandises – circulent chaque jour dans les zones sus- cités ». Ce qui constitue un danger quasi constant d’évènements de déversement d’hydrocarbure pour les côtes malgaches, composées de mangroves et de récifs coralliens. Et les cas existent si l’on se réfère aux dires d’un responsable, auprès de l’OLEP, qui a préféré taire son nom. Ce dernier de signifier « Faux Cap, situé au Sud de Madagascar, par sa nature d’autoroute maritime, est souvent touché par les cas de déversement ». Madagascar dispose, par ailleurs, d’un plan de lutte régionale, sous régionale et nationale, permettant de faire face à de tels cas. « Leadé » par l’OLEP, les initiatives de lutte consistent à prioriser la protection des zones présentant des intérêts écologiques, économiques et touristiques. Lesdites actions consistent également à contenir et disperser les hydrocarbures déversés. Pour l’heure, l’organisme responsable des réponses continue, tant bien que mal, de protéger les côtes malgaches des dangers qui les guettent tous les jours. Et ce, malgré le manque de moyens auquel il fait face. Si bien que la peur monte facilement lorsque l’on pense à un cas comme l’AMOCO CADIZ de Mars 1978, qui a provoqué une marée noire de 400 km.
José Belalahy