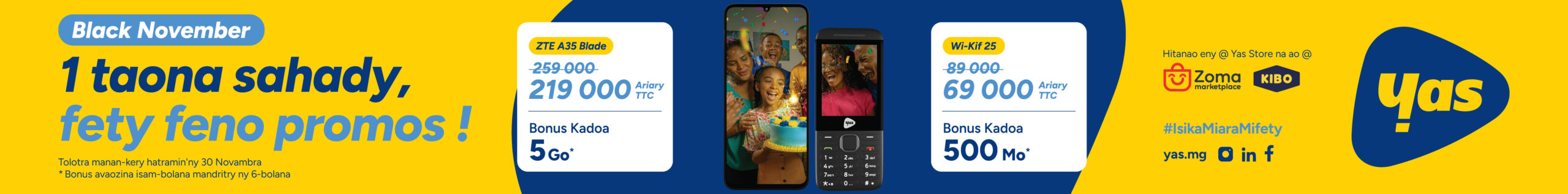Asie, Afrique, Europe, Amerique, d’un océan à l’autre, la génération Zoomer génère un mouvement de contestation. Les causes de la revendication sont les mêmes : la corruption, la liberté d’expression, l’équitabilité, l’injustice…
Dans certains pays, le système semble statique. À Madagascar par exemple, le concept politique hérité depuis l’indépendance demeure inchangé bien que les dirigeants se soient succédé. L’évolution de l’économie est en dent de scie… rouillée. Le fossé séparant les riches et les pauvres est de plus en plus profond. L’État ne parvient guère à subvenir aux besoins de son peuple. « Le gouvernement est considéré comme le raiamandreny, le parrain. Par contre, ses jeunes sont négligés. Depuis deux décennies, leurs voix ne sont pas écoutées », explique le sociologue Arsène Jao. Par conséquent, la jeune génération prend en main son destin. L’avènement de la technologie, les réseaux sociaux seront des moyens pour se démarquer. Ainsi, grâce au progrès technologique, elle sera une autodidacte. Elle s’instruit par ses propres moyens car le système éducatif est inadapté à la réalité. En revanche, les anciens l’accablent de reproches, « trop connectée, insoucieuse, promise à un avenir incertain ». Oui, l’avenir paraît incertain : la pédagogie demeure enfermée dans la théorie. Depuis une dizaine d’années, cette remise en question du système éducatif s’exprime d’ailleurs avec une ironie croissante sur les réseaux sociaux. À l’heure où la numérisation transforme les sociétés, nos manuels scolaires continuent d’illustrer les trois parties du corps d’un criquet, tandis que d’autres pays tracent déjà les contours d’un avenir technologique. Pendant ce temps, les enfants des élites politiques poursuivent leurs études à l’étranger. Une postérité… promise à la prospérité.

Abandonnée. Du reste, les infrastructures scolaires et les campus universitaires sont en piteux état. Les dortoirs sont insalubres et étroits. Les laboratoires datent des années 1980. Ce qui a poussé une étudiante du CRINFP à faire des recherches sur la population des rats dans le campus d’Antsiranana. À plusieurs reprises, ces futurs cadres ont exprimé leur mécontentement, sans que les responsables n’esquissent le moindre geste. Paradoxalement, ces derniers s’opposent dès que les étudiants prennent des initiatives. « Des associations d’étudiants ont proposé de nettoyer et de réhabiliter les bâtiments. Les responsables ont catégoriquement refusé », témoigne l’un d’eux. Sans surprise, ces étudiants sensés être l’avenir du pays nourrissent une profonde frustration, source d’une colère grandissante.
Ras-le-bol de la politique
Nés entre 1997 et 2012, une partie des Zoomers malgaches a grandi au rythme des crises politiques de 2002 et 2009, puis de la mobilisation des 73 députés en avril 2018. Ces événements ont marqué durablement leur mémoire collective. Pour eux, les politiciens ne sont que des opportunistes qui prétendent combattre le système, avant de reproduire les mêmes travers une fois au pouvoir. C’est pourquoi beaucoup rejettent ces « politicards » et leurs tentatives d’influence.
« Nous ne voulons pas de ces dinosaures. Ils ont fait leur temps. En plus, ils essaient toujours de manipuler les jeunes — c’est dans leur nature. Nous n’avons pas besoin de leader : que chacun apporte ce qu’il a. S’ils peuvent le faire sans arrière-pensée, qu’ils viennent… Mais je doute qu’ils en soient capables », confie Xavier Ferdi Rasamy, étudiant de 23 ans.

Un peu comme en 72. Les spécialistes en sciences humaines et sociales estiment que la rupture intergénérationnelle remonte au début des années 1970.Certes, comparée à la jeunesse actuelle, la génération des baby-boomers malgaches a grandi dans des conditions plus favorables. À l’époque, la domination française sur tous les plans nourrissait le mécontentement et stimulait le mouvement pour la malgachisation : les intellectuels réclamaient alors une administration et un système éducatif adaptés au contexte national.

Sous un autre angle, les influences venues d’Occident ont profondément marqué cette génération. Les idéaux de liberté des hippies californiens et la révolte étudiante de mai 1968 en France ont éveillé la curiosité des citadins malgaches. Dans une Grande Île tout juste indépendante, cette jeunesse s’est heurtée à une autre forme de résistance : entre quête identitaire et désir d’émancipation, elle refusait elle aussi la tutelle des anciens politiciens.
« Les membres de l’AKFM voulaient profiter du mouvement pour accéder au pouvoir, mais ils ont été repoussés. Les contextes étaient différents, certes, mais l’énergie et l’atmosphère ressemblaient beaucoup à celles de la génération Z », analyse l’historien Dr Radebason.

Nés dans les années 1950, ces « papy-boomers » ont été éduqués avec rigueur, à la croisée de la culture européenne et des traditions malgaches. Ce double héritage a souvent créé un sentiment d’étouffement, un besoin de se libérer. L’indépendance du pays, qu’ils ont vécue pour beaucoup à l’âge de dix ans, a nourri leurs ambitions. À vingt ans, l’heure était venue d’exprimer cet enthousiasme longtemps contenu.
Contrairement à la génération Z, née à l’ère numérique, leurs aînés s’informaient grâce à des journaux importés par bateau. Il a ainsi fallu près de quatre ans pour que leur propre mouvement prenne forme. En 1972, enfin, les étoiles semblaient alignées.
Au fond, l’histoire se répète : d’une génération à l’autre, les mêmes aspirations reviennent, comme un cycle inévitable de la vie.
Iss Heridiny