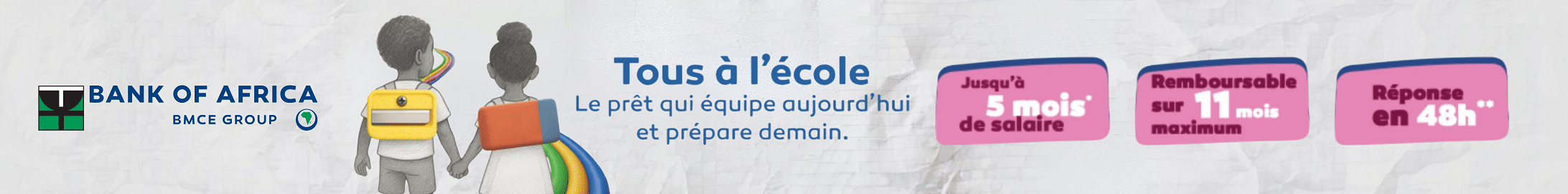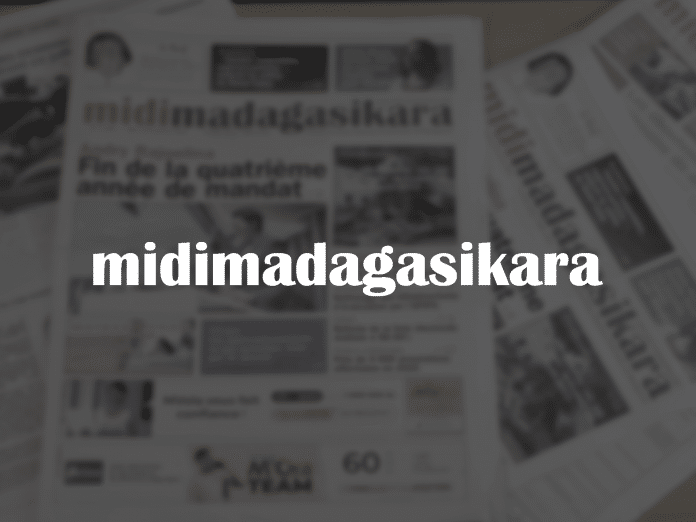La digitalisation et l’avenir du numérique de l’enseignement supérieur étaient au centre d’une initiative de dialogue public, « Parlons Développement », organisée par la Banque mondiale et le PNUD en partenariat avec l’Université d’Antananarivo et les associations pédagogiques étudiantes.
« Dans quelles mesures la digitalisation peut-elle révolutionner l’expérience universitaire ? ». La question a été au centre des attentions, hier, à l’Université d’Antananarivo dans le cadre de la deuxième édition de « Parlons développement », offrant un espace de dialogue public, donnant cette fois la parole aux étudiants. Une occasion d’aborder les questions essentielles en matière de digitalisation, notamment au niveau des obstacles et des opportunités pour une digitalisation efficace de l’enseignement supérieur à Madagascar.
Faible accès à Internet
A l’heure où le pays ambitionne de devenir un hub technologique, si l’on se réfère au Plan Stratégique du Numérique couvrant la période 2023-2028, il subsiste quelques défis à relever, notamment au niveau de l’accès à la « grande toile », vu le faible taux de pénétration d’Internet : 22% en 2022 selon les données de la Banque mondiale. De même, l’accès aux équipements numériques demeure limité, tandis que les capacités nationales en termes de formations adaptées aux nouveaux outils sont assez faibles. Par ailleurs, les inégalités au niveau des infrastructures entre les zones urbaines et les zones rurales sont flagrantes, privant ces dernières des possibilités d’accéder à l’enseignement numérique.
Réalités africaines
Ces constats confirment pour Madagascar une réalité commune à la majorité des pays d’Afrique : un accès encore faible à l’enseignement supérieur via le numérique. En effet, selon l’UNESCO, en 2023, moins d’un tiers des universités africaines disposent de véritables plateformes d’e-learning. A Madagascar, moins de 15% des établissements d’enseignement supérieur publics sont équipés pour dispenser un enseignement numérique de qualité. Madagascar accuse ainsi un retard dans le domaine de la digitalisation dans le milieu universitaire, alors que celle-ci, dans un pays comptant 64% de sa population âgée de moins de 25 ans, pourrait représenter un levier de transformation sociale, d’innovation et de compétitivité. A l’inverse, un accès inégalitaire ou inexistant risque de creuser davantage les fractures sociales, territoriales et générationnelles, comme l’a soulevé le représentant résident du PNUD, Edward A. Christow. « Le développement ne se décrète pas, il se construit avec les citoyens – et notamment avec vous les jeunes. Votre voix, vos aspirations, vos solutions sont essentielles pour bâtir l’avenir », a-t-il souligné, hier, à la cérémonie d’ouverture de « Parlons Développement », devant un parterre d’étudiants, d’enseignants et d’autres acteurs engagés dans le développement numérique et l’enseignement supérieur.
Pistes
Quelques pistes intéressantes sont à explorer dans le domaine de la digitalisation des universités à Madagascar, notamment au niveau de la valorisation des initiatives existantes telles qu’Orange Digital Center et IT University, et du renforcement de la collaboration entre universités, opérateurs télécoms, ministères, entreprises, partenaires et société civile. Une démarche largement soutenue par les étudiants, qui n’ont pas manqué d’exprimer en mots leurs maux dans ce domaine de l’accès au numérique dans l’enseignement supérieur. Objectif atteint, pour « Parlons Développement », dont l’objectif est de proposer une série de dialogues constructifs sur les enjeux du développement durable à Madagascar.
Hanitra R.